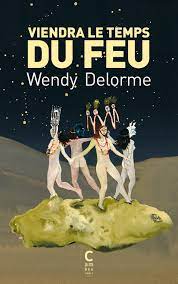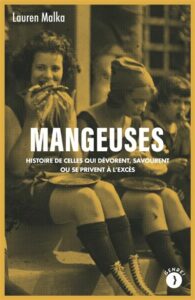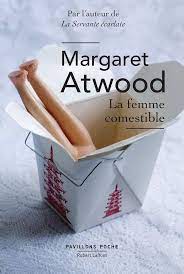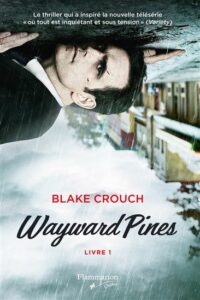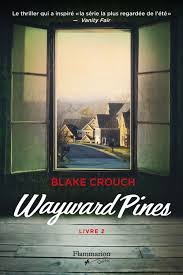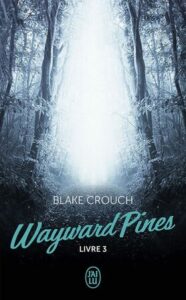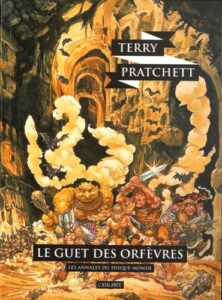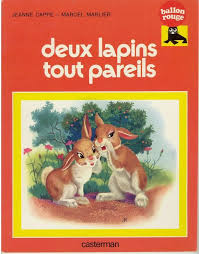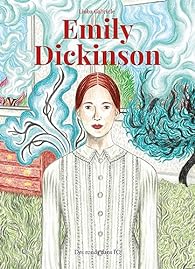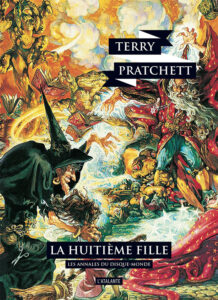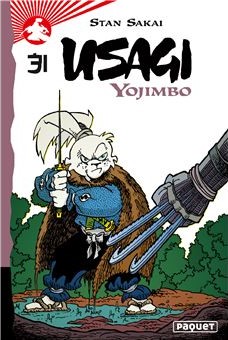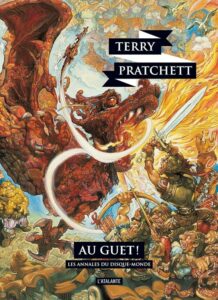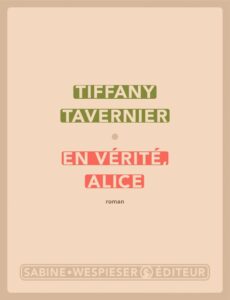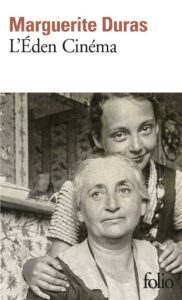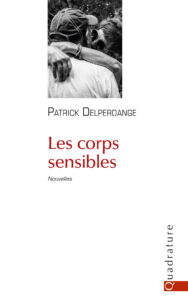Essai de Lauren Malka.
Impossible d’ignorer les injonctions culturelles et médiatiques à la minceur qui sont adressées, plus ou moins subtilement, aux femmes. Être mince, c’est être belle : donc, manger, c’est le risque de ne pas/plus être belle. C’est donc un besoin vital, une nécessité absolue qui sont diabolisés. « Les hommes n’ont pas besoin, par nature, d’aliments plus énergétiques que les femmes, si ce n’est pour entretenir leur domination sociale et politique. Les femmes, en revanche, payent très cher – dans certains cas, de leur vie – les conséquences de cette répartition inégalitaire. » (p. 217) À suivre la démonstration de l’autrice, on comprend que l’obsession névrosée pour le poids des femmes n’est pas récente : depuis toujours, on leur impose la minceur tout en exigeant des courbes bien placées qui leur rappellent qu’elles ont des fonctions nourricières à remplir.
De l’appétit alimentaire à l’appétit sexuel, le pas est simple à franchir. La femme qui mange trop est forcément débauchée et tentatrice. « Ève se retrouve non seulement accusée d’avoir commis le péché de gourmandise, mais aussi celui de l’incarner en devenant elle-même aussi dangereuse et appétissante qu’un fruit défendu. » (p. 65) Il appartient donc aux hommes, malheureuses victimes (non) des comportements féminins déviants et immoraux, de corriger les gourmandes.
En contrôlant l’appétit, voire la satiété des femmes, la société patriarcale (oui, disons les termes !) contrôle les forces de ces dernières et les tient bien sages. « Priver les femmes […] de nourriture est la façon la plus radicale de les isoler, d’amoindrir leur parole et d’invalider leur combat. Partager le pain de la sororité et le plaisir de manger apparaît alors comme un point de départ crucial pour s’émanciper. » (p. 17 & 18) Ce qui est terrible, c’est que les femmes se sont approprié ces restrictions : l’autocontrôle intégré facilite grandement la coercition des hommes !
La grande cuisine et la gastronomie ne seraient pas des affaires de femmes, si l’on en croit ces messieurs : il ne faut pas confondre la popotte domestique et l’art culinaire. On dénie donc aux femmes le talent de créer des plats fabuleux et l’intelligence d’être gastronome et on se moque de leur ambition d’être aussi qualifiée qu’un homme sur le sujet. « Il y a donc un effort supplémentaire à fournir pour ne pas être sexualisée ni traitée d’idiote. » (p. 143) Heureusement, les lignes bougent : les femmes s’emparent de tous les sujets, et gare à celleux qui voudraient les empêcher !
Nourri de références littéraires, universitaires, cinématographiques et télévisuelles, l’essai de Lauren Malka fait la part belle aux entretiens et aux confidences de femmes. L’autrice elle-même parle de son rapport à la nourriture. S’il semble indispensable de réfléchir à l’acte de manger ou de ne pas manger, il est tout autant indispensable d’écouter ce que racontent celles qui souffrent de troubles du comportement alimentaire. Chacune doit s’approprier son récit alimentaire et accueillir celui de ses sœurs attablées ou désattablées. « Le féminisme est un voyage qui, comme tous les autres, commence par la question : qu’y a-t-il à manger ? » (p. 14)
J’ai depuis longtemps un rapport tendu avec mon corps. Adolescente obèse, le corps débordant de bourrelets et le souffle court au moindre effort, je suis devenue une femme adulte perpétuellement complexée. Certes, je ne suis plus obèse et mon cardio va très bien, merci le sport. Mais mon image dans le miroir est un tableau d’horreur pour mes yeux. Je suis gourmande, irrémédiablement, mais je mange équilibré, surtout depuis que je suis végétarienne. Pour autant, je culpabilise à chaque bouchée, à chaque gourmandise, à chaque pensée alimentaire. De nombreuses pages du texte de Lauren Malka m’ont émue au cœur parce qu’elles parlent de moi et de mes fêlures, mais m’aident aussi à relever la tête et à la garder haute : mon corps est comme il est, stop à l’automaltraitance ! Cet ouvrage intelligent et sensible rejoint sans faillir mon étagère de livres féministes.